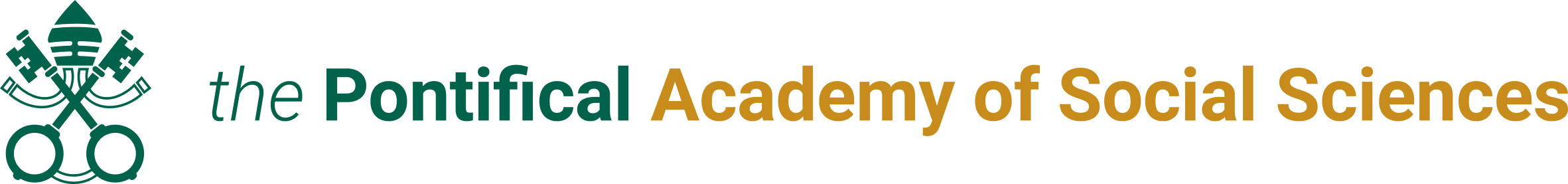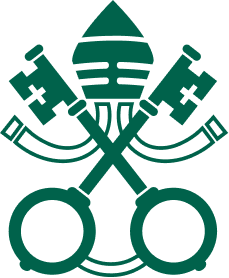Le problème
Des migrations catastrophiques mettent des millions d'êtres humains dans une situation de grands risques. Il y a aujourd’hui dans le monde plus de 65 millions de personnes dont le déplacement est forcé : l'équivalent des hommes, femmes et enfants vivant dans ces grandes villes que sont Lagos (16 millions), Sao Paulo (12), Séoul (10), Londres (9), Lima (8,5), New-York (8,5), et Guadalajara (1,4), une population qui, terrorisée, s’échappe dans l'inconnu avec quelques effets personnels.
La majorité de ceux qui cherchent refuge sont des personnes déplacées à l'intérieur d'un pays, et non des réfugiés enregistrés comme tels et franchissant des frontières internationales. En outre, environ neuf sur dix des personnes recherchant un asile international demeurent dans une contrée voisine de la leur : les Asiatiques restent en Asie, les Africains en Afrique, les Américains en Amériques.
Les migrations sont complexes et déterminées par des facteurs multiples. Elles sont causées par des facteurs socio-économiques et démographiques, mais également par la guerre et la terreur. Elles mettent en jeu des modèles culturels, des pratiques sociales, des processus politiques, des relations historiques, la dégradation de l'environnement et les catastrophes naturelles. Lors des dernières décennies, le changement climatique émerge comme une source majeure de migration.
Le Colloque a discuté avec préoccupation le fait que les déplacements internes associés à des conflits ou de la violence n'ont cessé d'augmenter depuis le début du millénaire, l'année 2015 représentant la valeur la plus élevée atteinte. Le Colloque nota également que le Proche-Orient – dépassant la contribution du reste du monde – est en tête par le nombre d'êtres humains déplacés par la guerre et la terreur. En 2015, trois pays seulement, la Syrie[1], l'Irak, et le Yémen sont à l'origine de plus de la moitié de tous les déplacés internationaux[2]. De même, plus de la moitié de tous les réfugiés placés sous le
... Read allLe problème
Des migrations catastrophiques mettent des millions d'êtres humains dans une situation de grands risques. Il y a aujourd’hui dans le monde plus de 65 millions de personnes dont le déplacement est forcé : l'équivalent des hommes, femmes et enfants vivant dans ces grandes villes que sont Lagos (16 millions), Sao Paulo (12), Séoul (10), Londres (9), Lima (8,5), New-York (8,5), et Guadalajara (1,4), une population qui, terrorisée, s’échappe dans l'inconnu avec quelques effets personnels.
La majorité de ceux qui cherchent refuge sont des personnes déplacées à l'intérieur d'un pays, et non des réfugiés enregistrés comme tels et franchissant des frontières internationales. En outre, environ neuf sur dix des personnes recherchant un asile international demeurent dans une contrée voisine de la leur : les Asiatiques restent en Asie, les Africains en Afrique, les Américains en Amériques.
Les migrations sont complexes et déterminées par des facteurs multiples. Elles sont causées par des facteurs socio-économiques et démographiques, mais également par la guerre et la terreur. Elles mettent en jeu des modèles culturels, des pratiques sociales, des processus politiques, des relations historiques, la dégradation de l'environnement et les catastrophes naturelles. Lors des dernières décennies, le changement climatique émerge comme une source majeure de migration.
Le Colloque a discuté avec préoccupation le fait que les déplacements internes associés à des conflits ou de la violence n'ont cessé d'augmenter depuis le début du millénaire, l'année 2015 représentant la valeur la plus élevée atteinte. Le Colloque nota également que le Proche-Orient – dépassant la contribution du reste du monde – est en tête par le nombre d'êtres humains déplacés par la guerre et la terreur. En 2015, trois pays seulement, la Syrie[1], l'Irak, et le Yémen sont à l'origine de plus de la moitié de tous les déplacés internationaux[2]. De même, plus de la moitié de tous les réfugiés placés sous le mandat du Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations-Unies (HCR) viennent de trois états : la Syrie (4,9 millions) au Proche-Orient, l'Afghanistan (2,7) en Asie et la Somalie (1,2) en Afrique. Les conflits qui durent en Afrique ont engendré des migrations forcées massives. Le Nigéria, la République démocratique du Congo, la République centrafricaine et le Sud-Soudan font partie des dix nations, qui totalisent en 2015 le plus grand nombre de nouveaux déplacements internes résultant de violence.
Stopper ces conflits est une priorité humanitaire.
Changement climatique incontrôlé et migrations catastrophiques
Le Colloque a soigneusement examiné le réseau de liens qui existent entre les déplacements massifs et les perturbations climatiques, la guerre et la terreur. Les perturbations climatiques augmentent la morbidité et la mortalité, désorganisent la production, décroissent les rendements agricoles, déciment les troupeaux et déplacent de force des millions d'êtres humains dans le monde entier. En 2015, des catastrophes ou dangers liés au climat ou à la météorologie ont ainsi déplacé 14,7 millions d'êtres humains qui ont dû quitter leur lieu de vie. En outre, 4,5 millions de déplacements ont résulté de catastrophes naturelles, tels les tremblements de terre. Sur la décennie écoulée, plus de 200 millions de déplacements ont été enregistrés, soit une moyenne de près de 25 millions de déplacements forcés chaque année.
Nous vivons dans l'époque de l’Anthropocène, celle pendant laquelle les humains ont émergé en tant que facteur majeur ayant un impact sur chacun des éléments du système Terre. À cause des émissions de dioxyde de carbone et d'autres polluants contribuant au réchauffement climatique depuis le début de l'industrialisation, la Terre, son atmosphère et ses océans se sont réchauffés d'environ 1°C. Cette fièvre planétaire a déjà produit des perturbations climatiques majeures telles que des vagues de chaleur, de sévères tempêtes, des inondations et sécheresses. Avec des émissions incontrôlées, le réchauffement excédera vraisemblablement 1,5°C en 2030, 2°C en 2050 et une valeur profondément déstabilisante de 4°C en 2100. Une élévation du niveau de la mer, entre 1 à 2 m, est vraisemblable en 2100, s'ajoutant à des vagues de chaleur extrême, à des tempêtes tropicales, à la fusion des glaciers et à des sécheresses prolongées.
Nous mettons en garde les chercheurs en sciences sociales et les responsables politiques sur le fait qu'une telle amplitude de réchauffement, ainsi que la vitesse de ce réchauffement, n'ont pas de précédent dans le passé, par comparaison avec les changements climatiques observés dans les derniers milliers d'années. Toute tentative d'extrapoler les liens de causalité, existant entre les changements climatiques et les migrations humaines, en s'appuyant sur des mesures passées, afin de prévoir le futur est sans doute non-fiable. Cela pourrait conduire à sévèrement sous-estimer les menaces auxquelles il faudra faire face lors des décennies à venir. Néanmoins, la sécheresse sur plus d'une décennie, les faillites agricoles, l'urbanisation dramatique et le manque de réponses gouvernementales en Syrie représentent une illustration explicite des risques courus.
Étant donné nos incertitudes sur les effets non-linéaires de rétroaction, engendrés par un réchauffement sans précédent, il existe une chance sur vingt que le réchauffement puisse atteindre la valeur catastrophique de 6°C en 2100. Alors que la plupart des actions politiques se focalisent sur des valeurs moyennes allant de 2° à 4°, nous nous faisons ici les avocats d'une analyse qui prépare les citoyens, non seulement aux valeurs moyennes précédentes, mais également aux hypothèses de réchauffement futur ayant des probabilités plus faibles, 6° en 2100 avec une probabilité de 5% par exemple.
Sans contrôle des émissions de gaz à effet de serre, les déplacements de masse et les migrations peuvent devenir une menace majeure pour les trois milliards d'humains les plus pauvres dans les décennies à venir, ainsi que pour la population entière de la Terre en 2100. La bonne nouvelle est qu'il est encore temps de réduire les émissions et d'éviter de tels risques systémiques pour les enfants, nos petits-enfants, et nous-mêmes.
Nous avons examiné les déplacements bien mesurés qui sont causés par des impacts environnementaux partout dans le monde. Inondations, tempêtes, cyclones, moussons, hurricanes, tremblements de terre, éruptions volcaniques, feux de forêts, glissements de terrain et températures extrêmes ont déplacé des millions de personnes en 2015. Les participants au Colloque ont noté que l'Inde[3], la Chine[4] et le Népal[5] représentent le nombre le plus élevé en proportion de personnes déplacées.
En résumé, le HCR a prédit que le changement climatique serait “la plus grande cause de déplacements de populations à l'intérieur des pays et hors des frontières nationales“. Bien qu'il existe un consensus général sur le fait que les estimations quantitatives sont encore aujourd'hui non-fiables, nous insistons sur la nécessité de mesures fiables pour élaborer une réponse, par une politique éthique globale, à cette crise des migrations climatiques. Une coopération internationale sur l’adaptation au changement climatique est urgente. L'établissement de protocoles internationaux qui précisent les droits des réfugiés climatiques et la responsabilité des nations industrialisées envers eux ne peut attendre.
Nous appelons de nos vœux une approche probabiliste qui tienne compte des différentes projections climatiques, en incluant les probabilités basses associées à des risques élevés, et qui combine une métrique quantitative, capable d'évoluer, avec de solides études de cas qui documentent les causes et les effets à partir d’expériences humaines concrètes de migrations climatiques. La justice climatique pour les pauvres du monde est tout autant une bataille contre la culture de l’indifférence qu'elle est vis-à-vis de la redistribution des responsabilités ; et des narrations authentiques, exprimées par les arts et la culture, peuvent faire percevoir l'impact humain du changement climatique mieux que des chiffres abstraits et froids.
Une nouvelle carte
En ce XXIe siècle, des millions d'êtres humains se trouvent dans des camps, loin des riches villes de l'Europe, de l'Amérique du Nord et de l'Australie. Des millions attendent un asile ; et d'autres millions vivent illégalement comme immigrant irrégulier ou sans autorisation de séjour. Les États-Unis sont le pays contenant le plus grand nombre d'immigrants au monde, dont environ 11,3 millions d'immigrants sans documents d'autorisation et 5,2 millions d'enfants dont au moins un parent immigrant vit sans ces documents. La grande majorité de ces enfants (4,5 millions) sont des citoyens des États-Unis où ils sont nés. Mais ces enfants vivent dans un contexte d'illégalité, craignant constamment le renvoi ou des séparations familiales soudaines. Le président Barack Obama a renvoyé plus de 2,5 millions d'immigrants pendant les huit dernières années. Le président Trump a promis d'augmenter le nombre de ces renvois, de construire un mur de 3000 km le long de la frontière mexicaine, et d'empêcher les Syriens et autres réfugiés d'entrer aux États-Unis.
Tout ceci représente de nouvelles formes de migrations forcées, qui n'entrent pas dans les schémas politiques existants.
À la suite de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe, les États-Unis et leurs alliés avaient mis en place un ensemble de politiques en faveur des réfugiés, fondées sur l'hypothèse que ce qui les avait conduits à fuir leur pays serait éventuellement résolu. Les nations civilisées pouvaient promettre le non-refoulement, le droit de ne pas revenir à un lieu de violence ou de persécution, parce que la promesse valait pour un temps conçu comme limité.
Mais aujourd'hui, des conflits prolongés conduisent à la fuite de millons d'êtres humains qui n’ont nul espoir de retour. En 2014, sur 33 conflits dans le monde, la moyenne de la durée de l'exil était de 25 ans.
De fait, le Colloque a examiné ces conflits prolongés et ces dévastations environnementales qui n’offrent que de faibles perspectives de retour en sécurité. Les conflits dans les pays ayant provoqué les nombres les plus importants de personnes déplacées de force, tels que la guerre et la terreur en Syrie, en Afghanistan et en Somalie ont duré plus longtemps que les Première et Seconde Guerres mondiales réunies. Des millions d'humains fuient des menaces sur leur existence, mais ne satisfont pas aux règles standard pour obtenir le statut de réfugié. Des millions appartenant à cette catégorie viennent de pays dont les populations sont extrêmement jeunes, en Afrique et en Amérique latine.
La jeunesse face aux migrations catastrophiques
Aujourd'hui également, les enfants sont un signe. Ils sont un signe d'espoir, un signe de vie, mais également un signe diagnostic, un marqueur indiquant la santé des familles, de la société et du monde entier. Là où les enfants sont acceptés, aimés, protégés et soignés, la famille est saine, la société est plus saine et le monde est plus humain.
L'éducation des enfants est également notre indication la plus précoce sur le fait qu'ils seront capables de développer pleinement leur potentiel comme être humain et de contribuer à la société, ou bien qu’ils deviendront de plus en plus vulnérables aux malheurs de la pauvreté, de la rupture sociale, de la “culture du déchet“ avec le trafic humain, du lavage de cerveau et du terrorisme. Dans ce contexte, l'éducation des enfants réfugiés et migrants prend un caractère d'urgence qui ne peut pas être sous-estimé. Les enfants ont le visage en larmes de ceux qui sont déplacés de force. Ce visage nous oblige à réexaminer les causes des migrations catastrophiques et nos responsabilités dans la recherche de solutions. Le visage des migrations catastrophiques du XXIe siècle est celui de la jeunesse. Nous avons noté que globalement un enfant sur 200 dans le monde est un réfugié. En 2015, il y avait 28 millions d'enfants déplacés de force. En outre 20 millions d'enfants figuraient dans les migrants internationaux. La somme de ces deux nombres est maintenant plus importante que les populations du Canada et de la Suède réunies. En outre des millions d'enfants sont des migrants internes, séparés de leur famille.
L'année 2016 enregistra un nombre record d'enfants non accompagnés ou séparés, avec 98 400 demandes d'asile, principalement Afghans, Érythréens, Syriens et Somaliens, auprès de 78 pays, le nombre le plus important jamais enregistré. L'Europe a vu une augmentation dramatique des nombres d'enfants et de jeunes, incluant les enfants non accompagnés, arrivant du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et sub-saharienne, et de l'Asie du Sud. Plus de 30 % des arrivées par mer en Europe depuis octobre 2015 étaient des enfants ; pour certaines nationalités, incluant les Afghans et les Érythréens, les enfants forment la majorité des demandeurs d'asile. De même, en 2014, les États-Unis ont vu une augmentation significative d'enfants isolés fuyant l'Amérique centrale. Le nombre d'enfants et de jeunes déplacées par force majeure, arrivant en Europe et aux Etats-Unis, ne représente qu'une petite fraction du total global. Simplement parce qu'elles sont jeunes, les plus jeunes victimes des déplacements forcés demandent de nouvelles approches pour les protéger et les installer. Les protections et les architectures actuellement en place dans les camps de réfugiés sont généralement aveugles aux besoins de développement des enfants. Même lorsqu'une protection temporaire est possible ou désirable, des enfants en fuite requièrent davantage qu'un lieu sûr d'accueil. Ils ont besoin d'un lieu pour grandir. Ils ont besoin d'un foyer. Ils ont besoin de programmes qui soient mieux en accord avec ce que nous savons aujourd'hui sur la santé physique et mentale, les protections légales, et l'éducation. Si bien que pendant ces deux jours, les participants au Colloque ont cherché à identifier les besoins et les modèles nouveaux qui permettent de se préoccuper de la santé physique et mentale, des protections légales, de l'éducation et du bien-être des demandeurs d'asile, des réfugiés et des migrants irréguliers en se préoccupant particulièrement des enfants et de la jeunesse.
Priorités : éducation, santé mentale, et bien-être
Éducation
En vue d’un développement heureux de l'enfant à l’avenir, l’éducation est la clé, particulièrement pour celui dont l’enfance ou l’adolescence sont marquées par des déplacements, la guerre, le travail forcé, la prostitution, et les séquelles de trauma, de séparation familiale et de pertes. Outre la guerre et la terreur, des millions d'enfants voient chaque année leur éducation scolaire perturbée à cause de catastrophes naturelles. D'après un récent rapport des Nations-Unies, les enfants réfugiés ont cinq fois plus de chances de se retrouver non scolarisé que leurs équivalents non réfugiés. Parmi les adolescents, dont beaucoup ont passé la plus grande partie de leur vie en exil seuls 22 % ont accès à l'éducation secondaire. Seule la moitié des enfants réfugiés dans le monde ont un accès à l'éducation primaire, moins d'un quart peuvent accéder à une école secondaire et seulement 1 % accède à une éducation supérieure. Les déplacements forcés conduisent 37 millions d'enfants à ne pas être scolarisés. Si les gouvernements et la communauté internationale ne font pas de l'éducation des enfants déplacés par force majeure une priorité, il est impossible que le monde puisse atteindre l'objectif de développement durable ODD#4, promettant pour tous une éducation primaire et même secondaire de qualité, laquelle malheureusement apparaît déjà comme peu probable à l’horizon 2050.
Une amélioration dans l'accès à l'école ainsi que la qualité de l'éducation, quoique l'une et l'autre soient des objectifs fondamentaux, ne suffisent pas à assurer que les enfants réfugiés reçoivent une éducation adéquate. Des centaines de milliers d'enfants déplacés de force dans le monde ne peuvent pas aller à l'école parce qu'ils doivent travailler pour soutenir la famille, puisque leurs parents ne sont pas autorisés à travailler dans le pays d'accueil. Dans les camps de réfugiés, l'accent mis sur l'intégration de ces réfugiés dans les systèmes nationaux d'éducation tourne trop souvent court. La vie quotidienne des enfants dans les classes, comme discuté lors du Colloque, les laisse trop souvent isolés et exclus, sans la participation ou la stabilité qui leur permettrait de considérer leur avenir. De fait, le plus souvent, les enfants réfugiés n'ont pas accès à des programmes éducatifs qui soient clairement à long terme.
Une minorité d'enfants réfugiés se trouve dans des pays à haut revenu. L'Europe, l'Amérique du Nord, l'Australie en sont des exemples. Un certain nombre de pays en Europe, mais non pas tous, ont agi en conformité avec leurs valeurs et ouvert leurs frontières aux personnes recherchant la sécurité, fuyant la Syrie déchirée par la guerre. L'Union européenne a admis plus d'un million de réfugiés en 2016, un nombre sans précédent qui incluait plus de 200 000 enfants ayant l'âge de la scolarité obligatoire. Au maximum de la crise, la seule ville de Hambourg a dû trouver 400 nouvelles places d'école pour ces enfants réfugiés, chaque mois. Partout des bâtiments vides ont été transformés en salle de classe et de nouveaux enseignants embauchés sur une base quotidienne. Des volontaires ont aidé à transmettre les bases du langage national, oeuvrant auprès des familles pour les aider à organiser leur nouvelle vie dans un pays qui leur était étranger. L'expression courageuse de la Chancelière Merkel, “Wir schaffen das !“ est devenue une réalité grâce à de nombreux responsables municipaux, travailleurs sociaux, responsables éducatifs, enseignants et, ce qui est également important, un grand nombre de volontaires européens appartenant à toutes les classes de la société. Cette réponse à un drame humanitaire a mis en évidence le meilleur des citoyens et administrateurs en Europe. Ceci est le visage de l'Europe que nous pouvons chérir.
Mais il existe, malheureusement, une autre face de l'Europe, qui semble devenir sa face dominante. Ces faces rudes, indifférentes aux réfugiés et à leurs enfants, une face des politiques européennes qui négocient avec les vies de personnes désespérées. C'est une face qui se détourne des familles réfugiées et de leurs enfants bloqués dans des tentes sous la neige en Grèce ou en Croatie. C'est une face d'exploitation d'enfants réfugiés sur le marché du travail en Turquie, tandis que leurs familles sont prises en otage dans la pauvreté par ce qu'on appelle l'accord UE-Turquie. Nous sommes préoccupés par le fait que plus de 380 000 enfants en Turquie ne peuvent aller à l'école. Ceux qui peuvent aller à l'école reçoivent un enseignement dans les écoles particulières situées dans les camps de réfugiés, sont enseignés par des enseignants syriens s'il en existe de disponibles, qui enseignent le curriculum syrien. Un enseignement en turc comme seconde langue n'est pas fourni. Nous appelons cette génération de jeunes enfants les “locked-in“ de cette génération de réfugiés : ils ne pourront pas retourner en Syrie à échéance prévisible et ils demeureront sans moyens d'avenir. L'accord Turquie-UE n'a eu qu'un résultat : garder cette image d'un désastre humanitaire loin de la vue des Européens. La destinée de ces jeunes enfants, qui devraient être dans une école, a été confiée par l'Union européenne aux camps de Turquie et aux banlieues des villes turques. Ceci est un échec pour l'Union européenne et pour les citoyens européens, au nom desquels cet accord a été passé. Il n'y a pas de justification pour un traitement si inégal entre ceux qui ont pu entrer en Europe à temps et qui reçoive de l'aide et de l'éducation, et ceux dont le futur est en fait nié dans une salle d'attente. L'accord UE-Turquie a montré clairement que le droit de ces enfants à l'éducation n'est pas et ne doit pas être un élément des négociations politiques portant sur les réfugiés. Le droit à l'éducation est écrasé tandis qu’au même moment l'Union européenne se fait l'avocat de la protection des droits pour tous les enfants, quels que soit leur condition de vie.
Dans le cas le plus favorable, des millions d'enfants déplacés de force seront des réfugiés dans un pays d'accueil où les écoles locales tentent à des degrés divers de les enseigner et de les intégrer dans une société nouvelle pour eux. Mais aujourd'hui, moins d'un pour cent des réfugiés s'installe dans des contrées lointaines en Europe, aux États-Unis ou en Australie. La grande majorité des enfants déplacés passe des années, quelquefois des décennies, dans des pays voisins du leur, où ils sont généreusement accueillis comme au Liban ou en Jordanie, mais où les systèmes éducatifs sont sous tension extrême et où les institutions politiques ou économiques sont fragiles. La scolarisation de ces enfants est bien souvent loin d'être adéquate. Ils ont des enseignants qui ont une formation minimale, l'espace de l'école est loin d'être adéquat, le temps consacré à l'enseignement est raccourci, des barrières de langue et de cultures sont rencontrées. Ainsi, ils sont privés de l'accès à la connaissance et des possibilités de développement cognitif qu'ils méritent en tant qu'êtres humains fragiles.
Pour la scolarisation des réfugiés et des migrants, les participants au Colloque concluent que le développement de la capacité de lire et d'écrire dans la langue du pays d'accueil représente la première priorité. Mais ils concluent également que les écoles doivent s'assurer du fait que les enfants n'abandonnent pas leur propre langue maternelle, porteuse de leurs valeurs culturelles et essentielle pour la vie familiale. De plus, les participants soulignent l’importance d’une éducation dans les sciences de la nature, nécessairement corrélée avec l'acquisition d'un second ou d'un troisième langage. La science, même tout à fait élémentaire, est un bien universel. Elle stimule la curiosité naturelle des enfants et fournit un contexte trans-culturel riche et profond pour observer, nommer, comprendre la nature, et agir sur elle. De la même façon que jouer à un jeu relie des enfants d'horizons très différents, une leçon active de sciences peut rassembler des enfants extrêmement divers dans un exercice commun d'investigation. Pendant les deux décennies écoulées, des projets-pilotes dans le monde, soutenus par des scientifiques de haute réputation, ont établi de tels ponts dans des écoles multiculturelles, accueillant un grand nombre de migrants nationaux ou transnationaux. Dans ces écoles des enseignants ont été formés pour mettre en œuvre les bonnes pratiques de cet enseignement scientifique, observant l’éclosion et la floraison de la curiosité, tout autant que les progrès des élèves dans la confiance en soi, le développement linguistique, la capacité de raisonner, de dialoguer et de créer, donnant ainsi de l'espoir à l'enfant et à la famille. Dans la décennie à venir et avec des ressources adéquates, avec un soutien amplifié de la communauté scientifique et des gouvernements, cet effort passé fournit des ressources de base et pourrait aisément être amplifié de dix à cent fois en incluant les nouveaux défis du développement durable, de l'éducation aux changements climatiques et d’une implication responsable des enfants.
Les enfants rencontrent dans les camps de réfugiés des conditions bien pires. Au-delà de la nourriture et des soins de santé, la plus haute priorité pour leur avenir est de développer leurs capacités et leurs talents naturels. Ici encore, les introduire aux sciences de la nature en s’appuyant sur leur environnement peut être une façon de briser leur isolement et leur enfermement, d'ouvrir leurs yeux à la beauté de la nature, de leur donner des points de repères dans l'espace et dans le temps avec des équipements très simples à pratiquement un coût nul. En utilisant toutes les ressources, les capacités et les contacts qui ont fait dans les deux décennies écoulées le succès des projets-pilotes mentionnés plus haut, en ajoutant des outils d'enseignement à distance à la nécessaire relation physique entre l'adulte et l'enfant, un nouveau programme pour les camps devient possible, si et seulement si la volonté et les ressources sont présentes. Il faut si nécessaire rappeler aux gouvernements d'accueil que refuser à des enfants réfugiés l'accès à des écoles et à la connaissance est une négation de leur humanité.
Les participants au Colloque ont souligné le fait que l'éducation ne doit pas se limiter exclusivement à l’acquisition de connaissances, mais doit aussi éduquer la volonté en direction du bien commun, de l'amitié et de la charité. Elle doit devenir une force contre les maux de la guerre et de la terreur, contre tout traitement inhumain de l'autre. Ceci suggère l'importance d'enseigner les vertus et les valeurs, et en particulier la justice sociale, la solidarité envers ses pairs et les générations futures, autant que l'amitié et la convivialité.
Santé mentale et bien-être
Un déplacement forcé est nécessairement traumatisant. Les participants au Colloque ont examiné des données, devenues disponibles à partir de l'étude la plus importante faite à ce jour sur les camps de réfugiés en Grèce. Près de 30 % de ceux qui ont répondu avaient été témoins de la mort d'un membre de la famille ou d'un ami et 20 % ont témoigné avoir subi la torture. Le manque d'abri, de nourriture et d'eau, la vision de la mort autour de soi, l'expérience de menaces de mort et de torture, les passages violents de frontières sont des traumatismes fréquents dans les populations de réfugiés. L'étude faite en Grèce rapporte que la moitié de la population interrogée fait état de tels traumas. Le trauma engendre des maladies chroniques par ses effets directs et indirects, provoquant maladies mentales et modes de vie déséquilibrés. Ce rapport entre trauma et atteintes à la santé physique ou psychologique requiert qu’un accent renouvelé soit mis sur la santé.
La recherche montre aussi que des enfants ou des jeunes réfugiés, même s'ils ont subi une expérience difficile de trauma, peuvent grandir sainement si la chance leur en est donnée. Les participants au Colloque insistent sur le besoin, partout où c'est possible, de travailler avec les familles et de reconnaître les capacités des enfants lors de leur croissance. Nous suggérons une adaptation des interventions aux différences observées dans le développement de chaque enfant et dans le contexte familial. Il est important de mettre en avant des programmes qui reconnaissent et font progresser l'implication des jeunes et de leurs familles, en s'appuyant sur l'ambition de ces derniers pour progresser sur le plan éducatif, social et économique. Ces enfants et ces jeunes peuvent être les agents de leur propre guérison.
Les participants au Colloque plaident pour des programmes de santé mentale, qui tiennent compte des traumatismes et soient orientés vers la prévention, qui agissent en parallèle à un traitement centré sur le trauma lorsque nécessaire et qui incluent des modèles fondés sur l'école et la communauté. Pour les jeunes enfants et pour les familles les plus vulnérables et les plus difficiles à atteindre, des modèles de visites à domicile peuvent promouvoir des relations parents-enfants saines et améliorer le fonctionnement familial. Il est également important d'aider à construire des environnements qui réparent, en collaboration avec les populations affectées, afin que les enfants réfugiés et leurs familles puissent vivre, étudier, jouer et s'engager dans des expériences de développement et de normalisation, en dépit des circonstances très anormales de guerre et de déplacement.
La recherche montre que ces services sont les plus efficaces lorsqu’ils sont organisés au sein de la communauté et intègrent la santé physique et mentale, les services éducatifs, en parallèle avec des visites à domicile et une ouverture offerte ceux qui sont isolés socialement ou qui rencontrent d'autres obstacles à leur participation. Des modèles de soins progressifs peuvent combiner des préventions en première ligne et des modèles de promotion de santé mentale en parallèle avec un niveau plus élevé de soins de la santé mentale, incluant les traitements en groupe pour la dépression et des traitements individuels pour des réactions traumatiques au stress lorsque ces mieux indiqués. En travaillant de façon globale avec les familles, nous devons reconnaître que les parents ont trop souvent vécu des traumatismes et des pertes. Des approches sur deux générations, qui incluent à la fois ceux qui s'occupent des enfants et les enfants eux-mêmes, sont critiques pour aider les familles de réfugiés à s'ajuster au mieux à l'adversité qu'elles rencontrent, en incluant le développement d’une saine communication, des alternatives aux punitions sévères et un enrichissement des relations parents-enfants. Ces modèles de prise en charge, fondés sur la famille, peuvent également associer des membres pllus éloignés de celle-ci et fournir des éléments de référence à des adultes, qui bénéficieraient ainsi d'un niveau plus élevé de soins pour la dépression, les réactions traumatiques au stress, les abus d'alcool ou de drogue et les violences familiales. Pour dépasser l'impact des perturbations mentales et associer les communautés de réfugiés, nous devons également être attentifs à la façon dont nous communiquons sur l'amélioration de la santé mentale et du bien-être chez les enfants réfugiés ; nous devons nous efforcer de comprendre leur langage quand il s'agit de conceptions liées à l'émotion ou au comportement, aussi bien que de conceptions liées à la protection sociale et la résilience face à l'adversité. Nous devons également comprendre comment les facteurs de protection fonctionnent au niveau de l'individu, de la famille, des pères, de l'école et de la communauté, du niveau culturel, afin que l'on puisse s'appuyer sur les forces et les ressources présentes dans la communauté des réfugiés et dans leur culture, pour parvenir à des modèles d'intervention qui soient fondés sur des évidences, efficaces, capables de changement d'échelle, et soutenables. En particulier, nous devons considérer la meilleure façon de soutenir les communautés qui accueillent des réfugiés, afin qu'elles développent des services sociaux et de santé mentale adéquats pour tous les individus, à la fois dans les communautés d'accueil et dans les communautés de réfugiés pendant les périodes de déplacement massif.
Il est également critique de conceptualiser la façon de reconstruire dans des situations de post-conflit. Si bien que la réponse d'urgence dans les pays affectés par un conflit doit débuter avec une vision qui soit tournée vers la reconstruction, le renforcement et la garantie de la qualité et de la durabilité des services sociaux et de santé mentale dans ces pays affectés par un conflit, afin de faciliter la transition entre la période de déstructuration et de déplacement liée au conflit et celle qui lui sera postérieure.
Conclusion
L’essence même de l'humanisme est de reconnaître soi-même comme un autre. Cette reconnaissance doit être étendue à chacun et en particulier à ceux qui souffrent, tels que les réfugiés, jeunes ou vieux.
Le déplacement forcé de millions d'êtres humains représente une crise existentielle de notre époque, causant des souffrances à d'autres que nous devons considérer comme nous-mêmes. Des millions de personnes déplacées de force, de réfugiés, de demandeurs d'asile, de migrants non autorisés et irréguliers, nos frères et sœurs, sont placés dans des conditions barbares qui les privent de leur dignité humaine et de leurs propres capacités à se développer. Ces migrations catastrophiques du XXIe siècle sont particulièrement impardonnables envers des millions d'enfants.
En premier lieu, nous devons agir pour stopper les conflits qui engendrent les déplacements massifs les plus grands et les plus graves. En 2015, trois pays seulement – la Syrie, l'Irak et le Yémen – ont contribué à plus de la moitié de tous les déplacés internationaux. De même plus de la moitié de tous les réfugiés placés sous mandat des Nations-unies viennent de trois pays : Syrie, Afghanistan et Somalie. Mettre fin à ces conflits doit être la priorité absolue de la communauté internationale, de tous les hommes et femmes de bonne volonté. En second, nous appelons à un développement économique soutenable partout, tel que les personnes puissent demeurer dans leur propre pays en sécurité. Chaque enfant, particulièrement chaque fille, doit recevoir les soins de santé et l'éducation dont il a besoin. L'éducation des filles a déjà prouvé qu’elle produit de nombreuses cercles vertueux, parmi lesquels une fertilité abaissée, une santé améliorée, un bien-être et une sécurité économique supérieurs.
En troisième lieu, tous les organismes internationaux concernés doivent agir pour inverser un changement climatique incontrôlé qui entraîne des déplacements catastrophiques. Nous devons réussir une résilience climatique. Parallèlement, les participants au Colloque appellent la communauté internationale à redoubler d'efforts, afin d'investir dans la protection, l'éducation à la santé et le bien-être de tous ceux qui sont déplacés de force, en particulier tous les enfants et les jeunes. Il manque environ 8 milliards de dollars par an dans l'éducation d'urgence : ceci doit être corrigé immédiatement par les pays donneurs et la philanthropie globale. En dépit de nouveaux engagements à la suite de l'initiative Education cannot wait (“L’éducation ne peut attendre“), approuvée pendant le sommet humanitaire mondial de mai 2016, seule une focalisation renouvelée et résolue sur l'éducation des réfugiés peut combler ce fossé. À la suite de la Déclaration d’Incheon, les pays donneurs devraient allouer 0,7 % de leur PNB pour l'assistance et es pays développés devraient suivre ces recommandations pour dédier à l’éducation au moins 4 à 6 % de leur PIB, ou bien 15 à 20 % de leur dépenses publiques totales. Les réfugiés et les enfants déplacés de force devraient être inclus dans les politiques éducatives nationales des pays hôtes à égalité avec les nationaux.
De plus, nous implorons les gouvernements des pays d'accueil de faciliter l'accès des adultes réfugiés au marché du travail, un droit garanti par la Convention des réfugiés de 1951. La communauté internationale doit faire pression sur ces pays, particulièrement au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est, qui n'ont pas ratifié cette Convention, parce que le travail d’enfants en quasi-esclavage est, dans bien des crises, le facteur le plus important qui maintient les enfants hors de la scolarisation.
Par-dessus tout, nous devons transformer nos relations avec chaque autre personne et nous engager dans la recherche d'une nouvelle façon de vivre. Selon les mots du pape Francis, “chaque enfant, qui est né et qui grandit où que ce soit dans notre monde, est un signe-diagnostic qui indique l'état de santé de nos familles, de nos communautés, de notre pays. Un tel diagnostic, posé franchement et honnêtement, peut nous conduire à un nouveau mode de vie où nos relations ne soient plus marquées par le conflit, l'oppression et la consommation, mais le soient par la fraternité, le pardon et la réconciliation, la solidarité et l'amour“.
[1] Parmi ceux que le conflit syrien a déracinés, environ 6,6 millions de personnes ont été déplacées en interne au pays. Loin des medias et sans accès aux agences humanitaires, beaucoup luttent pour survivre dans des conditons infra-humaines (Rapport Global sur les Déplacements Internes, p.4).
[2] En 2015, on recense en Irak 3,3 millions de déplacés internes et 2,5 au Yemen (ibid.).
[3] “En Inde, deux inondations majeures et des tempêtes furent responsables de 80 % des déplacements, forçant 3 millions de personnes à fuir leurs logements. Des pluies considérables et des inondations brutales, associées à un faible cyclone tropical se déplaçant dans le Golfe du Bengale en novembre 2016, déplacèrent 1,8 million de personnes dans les États du Tamil Nadu et dans le sud de l'Andhra Pradesh. Des inondations de mousson, associé au cyclone Komen, qui frappa fin juillet le Bangladesh voisin, déplacèrent 1,2 millions, principalement dans les Etats du Bengale de l'Ouest, Odisha, Manipur, Rajasthan et Gujarat“. (Ibid, p.15)
[4] “Trois typhons à grande échelle et des inondations désastreuses simultanées provoquèrent 75 % des déplacements en Chine. Ces trois typhons, Chan-Hom, Soudelor et Dujan, frappèrent quatre provinces orientales entre juillet et septembre, détruisant des maisons, causant des glissements de terrain et des inondations et déplaçant plus de 2.2 millions de personnes. Plus tôt dans la même année, des pluies importantes et des inondations dans neuf provinces du Sud et de l'Est forcèrent 78 000 personnes à fuir leur domicile en mai.“ (Ibid. p.15)
[5] “Les tremblements de terre au Népal en avril et mai, les milliers de répliques qui suivirent et les glissements de terrain qu'ils provoquèrent endommagèrent ou détruisirent 712 000 maisons et beaucoup d'infrastructures. Le désastre éprouva lourdement cette nation en développement, affectant environ le tiers de la population et tuant 8 700 personnes. Beaucoup des 2,6 millions de personnes qui furent déplacées n'ont pas pu retourner chez elles et la reconstruction demandera bien des années.“ (p. 17)
Read Less